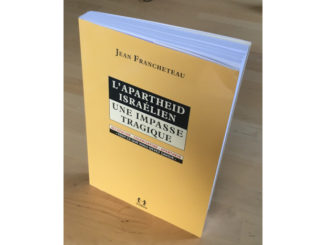Des travailleurs palestiniens dans l'attente au checkpoint de Qalqilya, en Cisjordanie - Photo : Activestills
Par Samah Jabr
Je commence ma journée comme si je m’élançais dans un étroit couloir interminable, les bras encombrés de dossiers de patient·es que je n’ai pas fini de lire, mon téléphone vibrant sans répit au rythme des notifications.
Je bois mon café debout, avale un morceau entre deux rendez-vous, et il m’arrive souvent de ne même pas trouver le temps d’écaler un œuf. Le poids des tâches à accomplir pèse sur chaque minute, avant qu’il ne soit déjà trop tard. Le temps me talonne, s’écoule entre mes doigts comme de l’eau, et ma vie s’emballe au rythme effréné d’un train fonçant à toute allure.
Pourtant, lorsque je me détache de cette confusion quotidienne, je bute contre une autre forme de temps – un temps qui passe à une lenteur insupportable. Il se compte en heures perdues aux checkpoints, en journées suspendues à attendre des permis, en années gaspillées à courir derrière des autorisations de construire qui n’arrivent jamais.
Tandis que je cours en permanence après mes propres obligations, je vis dans un temps collectif soumis au bon vouloir d’un·e soldat·e, à la signature d’un·e fonctionnaire, ou à un processus bureaucratique susceptible d’engloutir une vie entière.
Je me sens écartelée entre deux temporalités parallèles : ma propre course effrénée, et le tempo stagnant imposé à mon peuple. Peut-être mon rythme personnel, si frénétique, est-il lui-même une réaction à cette suspension collective.
Le colonialisme n’accapare pas uniquement la terre ; il confisque aussi le temps. Il accélère tout ce qui sert ses intérêts, et fait traîner tout ce qui touche à la vie palestinienne. Les colonies israéliennes s’élèvent en quelques semaines, les routes de contournement sont tracées en quelques mois, et les infrastructures conçues sans délai pour relier ces nouveaux centres urbains.
Pendant ce temps, une famille palestinienne de Jérusalem lutte pendant des années pour réparer un mur ou ajouter une pièce, perdue dans les labyrinthes de l’attente et de la paperasse. Tandis que le projet colonial avance avec une impitoyable rapidité, le temps palestinien se fige dans des files d’attente interminables, privé de toute capacité de planifier, d’agir ou de bâtir.
Dans mon cabinet, j’entends les récits de cette érosion quotidienne : les heures qui s’évaporent sur l’asphalte des checkpoints, les mois perdus en quête de permis, les vies entières consumées par une attente sans fin. Cette lenteur imposée s’insinue au plus intime, chargeant le présent d’anxiété, faisant de l’avenir l’otage de la volonté d’autrui, et du passé un chapitre inachevé.
L’érosion fracture le temps lui-même en fragments disjoints : pas de passé proprement refermé, pas de futur pleinement ouvert, et un présent réduit à la répétition de moments figés.
Chaque heure volée à un checkpoint est une heure effacée de la vie, sans restitution possible. Chaque rendez-vous reporté est un vol délibéré de notre ressource la plus précieuse : le temps. Dans cette économie de l’attente, les seul·es bénéficiaires sont les colonisateur·ices, qui tiennent les rênes du rythme collectif et condamnent ainsi les colonisé·es à tourner en rond jusqu’à l’épuisement.
Le temps devient à son tour un enjeu de lutte, un champ de domination tout autant que la terre elle-même.
Même notre rapport individuel au temps se déforme. Lorsque la capacité de planifier nous est retirée, les rêves à long terme se fanent, les ambitions se replient sur l’instant présent, au mieux sur un lendemain suspendu à l’incertitude. Le temps cesse d’être un espace de liberté pour devenir un lourd fardeau, et la vacuité de chaque minute nous ramène à la perte de maîtrise sur notre existence.
Je navigue entre mes obligations professionnelles, porteuse de ce paradoxe : prisonnière d’un rythme implacable, mais membre d’une société enchaînée par l’attente. Mon présent individuel constitue une course sans fin, pendant que notre réalité collective se tient immobile sur la ligne de départ, à attendre un signal qui n’arrive jamais. Nous le savons toutes et tous : nous sommes piégé·es dans un système où le temps colonial s’accélère indéfiniment, tandis que la vie palestinienne s’enlise dans la lenteur.
Et pourtant, même dans cette lenteur imposée, j’aperçois de discrets îlots de résistance. Je mange, j’appelle des ami·es, j’écoute des podcasts, je réponds à des mails debout à un checkpoint. D’autres transforment les heures d’attente en espaces d’apprentissage et trouvent ainsi du sens dans ces moments qui leur sont volés.
Chaque geste qui investit le présent, si minime soit-il, constitue une réappropriation du temps volé. Je le vois dans ces familles qui s’obstinent à célébrer les fêtes en dépit des restrictions, et dans ces parents déterminés à instruire leurs enfants malgré les barrières. Lorsqu’on y investit du sens, le temps devient un espace de liberté, même dans les pires conditions.
Notre mémoire collective représente elle-même un outil de résistance. Se souvenir, c’est reconnecter le passé et l’avenir, réparer la trame du temps que la colonisation tente de déchirer.
Chaque récit d’une vie avant l’expropriation et chaque vision de lendemains libérés, une fois retissés, renforcent la continuité du temps palestinien. La mémoire n’est pas l’archive du passé ; elle est expansion du présent, ouverture vers d’autres futurs.
Je pense souvent que nous réapproprier le temps fait partie intégrante de la lutte pour la libération. La liberté, ce n’est pas seulement la restitution de la terre, mais la reprise de notre droit à façonner nous-mêmes le rythme de nos vies.
Le temps colonisé constitue un autre front de la lutte. Et chaque moment investi de volonté et de sens nous rapproche d’une émancipation collective du temps lui-même.
Tandis que je poursuis ma propre course effrénée, je garde la certitude que la véritable liberté n’adviendra que lorsque le tempo collectif sera, lui aussi, libéré de la dépossession.
Auteur : Samah Jabr
 * Dr Samah Jabr est une psychiatre consultante exerçant en Palestine, au service des communautés de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, et ancienne responsable de l'unité de santé mentale au sein du ministère palestinien de la santé. Elle est professeur clinique associée de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université George Washington à Washington DC. Elle est également membre du comité scientifique de l'« Initiative mondiale contre l'impunité (GIAI) pour les crimes internationaux et les violations graves des droits de l'homme », un programme cofinancé par l'Union européenne.Dr Jabr est formatrice et superviseuse, avec un accent particulier sur la thérapie cognitivo-comportementale (CBT), le mhGAP et le protocole d'Istanbul pour la documentation de la torture. Elle s'intéresse particulièrement aux droits des prisonniers, à la prévention du suicide et aux traumatismes historiques.Elle est une femme écrivain prolifique. Son dernier livre paru en français : Derrière les fronts – Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation.
Le Dr Jabr intègre son expertise médicale à son activisme, abordant souvent l'impact psychologique de l'occupation, des traumatismes historiques et de la guerre. Elle est l'un des membres fondateurs du réseau mondial de santé mentale de la Palestine et donne de nombreuses conférences sur la psychologie de la libération et les responsabilités éthiques des professionnels de la santé mentale dans les zones de conflit.
* Dr Samah Jabr est une psychiatre consultante exerçant en Palestine, au service des communautés de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, et ancienne responsable de l'unité de santé mentale au sein du ministère palestinien de la santé. Elle est professeur clinique associée de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université George Washington à Washington DC. Elle est également membre du comité scientifique de l'« Initiative mondiale contre l'impunité (GIAI) pour les crimes internationaux et les violations graves des droits de l'homme », un programme cofinancé par l'Union européenne.Dr Jabr est formatrice et superviseuse, avec un accent particulier sur la thérapie cognitivo-comportementale (CBT), le mhGAP et le protocole d'Istanbul pour la documentation de la torture. Elle s'intéresse particulièrement aux droits des prisonniers, à la prévention du suicide et aux traumatismes historiques.Elle est une femme écrivain prolifique. Son dernier livre paru en français : Derrière les fronts – Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation.
Le Dr Jabr intègre son expertise médicale à son activisme, abordant souvent l'impact psychologique de l'occupation, des traumatismes historiques et de la guerre. Elle est l'un des membres fondateurs du réseau mondial de santé mentale de la Palestine et donne de nombreuses conférences sur la psychologie de la libération et les responsabilités éthiques des professionnels de la santé mentale dans les zones de conflit.
28 juillet 2025 – Transmis par l’auteure – Traduction : Chronique de Palestine – Ijtihad