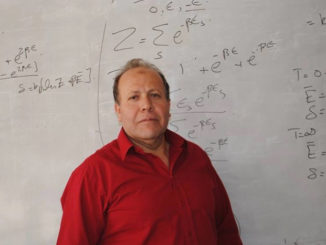Cueillette des olives en Palestine occupée - Photo : Réseaux sociaux
Par Jwan Zreiq
La violence d’Israël envers les Palestiniens va bien au-delà des bombes et des balles. Elle pénètre même le sol, ciblant ce que l’historien de l’environnement William Cronon pourrait reconnaître comme les « structures profondes » appartenant à ces relations matérielles entre les personnes et le lieu qui constituent la présence indigène.
L’arrachage systématique d’oliviers, dont certains sont centenaires, représente ce que nous pourrions théoriser comme du « colonialisme écologique » : la destruction délibérée des témoignages environnementaux afin de perturber les revendications des Palestiniens autochtones quant à leur lien avec leur terre.
Le 23 août 2025 seulement, l’armée israélienne a déraciné près de 3 000 oliviers dans le village d’al-Mughayyir, près de Ramallah, comme l’a rapporté Al Jazeera. Les soldats ont pris d’assaut le village à l’aube, ont fait une descente dans plus de 30 maisons, ont détruit des véhicules et ont imposé un confinement.
La raison officielle invoquée : les arbres représentaient une « menace pour la sécurité » d’une route menant à une colonie voisine.
Les responsables israéliens n’ont fourni aucune explication sur la manière dont des oliviers centenaires pouvaient menacer qui que ce soit. La réponse la plus logique est peut-être que la véritable « menace » qu’ils représentaient était le fait gênant que ces arbres, profondément enracinés et soigneusement entretenus, témoignaient de manière visible de la façon dont des générations de Palestiniens sont les gardiens indigènes de la terre.
Ces arbres représentent plus que l’agriculture ; ils sont la preuve de la présence palestinienne depuis des siècles. Leurs racines profondes et leur longévité constituent un témoignage vivant de l’attention que les Palestiniens indigènes portent à la terre.
Chaque arbre détruit efface les traces de la culture palestinienne et, avec elles, la preuve même de l’existence palestinienne. Les autorités israéliennes d’occupation comprennent que la suppression de ces preuves contribue à légitimer l’expansion des colonies et la confiscation des terres.
La destruction des arbres rend plus difficile la documentation et la défense des revendications palestiniennes sur ces terres.
L’olivier est indissociable de la terre elle-même. Chaque arbre porte en lui des siècles de travail des ancêtres, dont la présence est codée dans ses racines. Sa récolte permet de subvenir aux besoins des ménages, de financer l’éducation, de soutenir les mariages et d’assurer la vie quotidienne.
L’huile d’olive marque à la fois la survie quotidienne et les moments importants pour la communauté. Récolter, c’est perpétuer une lignée de soins, de compétences et d’appartenance que la violence coloniale cherche à briser. La protection de ces arbres est un impératif à la fois culturel et écologique.
Chaque arbre déraciné est un acte d’effacement environnemental et culturel, une attaque délibérée contre la continuité, la mémoire et la présence palestiniennes.
Au-delà d’al-Mughayyir, le schéma se répète dans toute la Palestine : à Burin, près de Naplouse, les colons incendient des oliveraies sous la protection de l’armée ; à Masafer Yatta, des bulldozers défrichent des terres agricoles et des pâturages désignés comme « zones de tir » ; à Salem, à l’est de Naplouse, les arbres sont abattus ou empoisonnés, tandis que les puits sont saisis.
Les méthodes varient, mais l’objectif reste le même : séparer les Palestiniens de leurs terres, rendre leur retour impossible et rendre le paysage méconnaissable sans ses gardiens autochtones.
Malgré des décennies de destruction, les communautés palestiniennes continuent de cultiver des olives, de planter pour un avenir qu’elles ne verront peut-être pas, mais qu’elles refusent d’abandonner. Tant que les Palestiniens resteront sur leurs terres, ils poursuivront le travail saisonnier de culture qui leur permet de conserver leur droit sur ces terres.
Visions environnementales contrastées
Cette détermination contraste fortement avec les efforts déployés par le mouvement sioniste dès 1920 pour remodeler le paysage. Le Fonds national juif (JNF), en coopération avec l’Association juive de colonisation de la Palestine (PICA), a planté des forêts de pins, de cyprès et d’autres arbres non indigènes, dans le but d’« européaniser » le paysage et d’affirmer son contrôle sur la terre.
L’idée était de transformer l’environnement pour refléter une esthétique européenne, renforçant ainsi le discours colonialiste.
Ces arbres sont devenus hautement inflammables en raison de leurs aiguilles résineuses et de leur croissance dense, contribuant à des incendies de forêt dévastateurs, tels que les incendies de Jérusalem en 2021, qui ont détruit plus de 20 000 dunams (4942 acres) de terres forestières.
De plus, les conditions acides du sol créées par ces plantations inhibent la croissance de la végétation indigène, perturbant davantage l’écosystème autochtone.
Contrairement à ces espèces non indigènes, les oliviers sont bien adaptés à la région, résistants à la sécheresse et au feu, et parfaitement en harmonie avec le terrain. Alors que les colons tentent d’imposer des arbres étrangers et de remodeler le paysage, la nature elle-même résiste à la revendication coloniale.
La résistance palestinienne à travers la replantation
Chaque bosquet replanté remet en question la logique coloniale d’élimination. Après huit décennies d’oppression systématique, les oliviers continuent de résister à travers la Palestine. Leur persistance défie l’hypothèse coloniale selon laquelle la présence indigène peut être effacée par la violence.
Ces arbres témoignent du soin que les Palestiniens apportent à la terre, résistant aux tentatives de rompre ce lien, quelle que soit la force utilisée contre eux.
Le déracinement peut persister, mais la replantation aussi. Dans cet acte, le sol conserve à la fois le souvenir de ce qui a été perdu et la promesse de ce qui perdurera.
Auteur : Jwan Zreiq
* Jwan Zreiq est une écrivaine palestinienne basée en Jordanie. Elle a une formation en développement de produits numériques et son travail explore les intersections entre l'identité, la résistance, la langue comme outil de revendication anticoloniale et les systèmes de pouvoir à travers des essais personnels et politiques.
18 septembre 2025 – The Palestine Studies – Traduction : Chronique de Palestine – YG